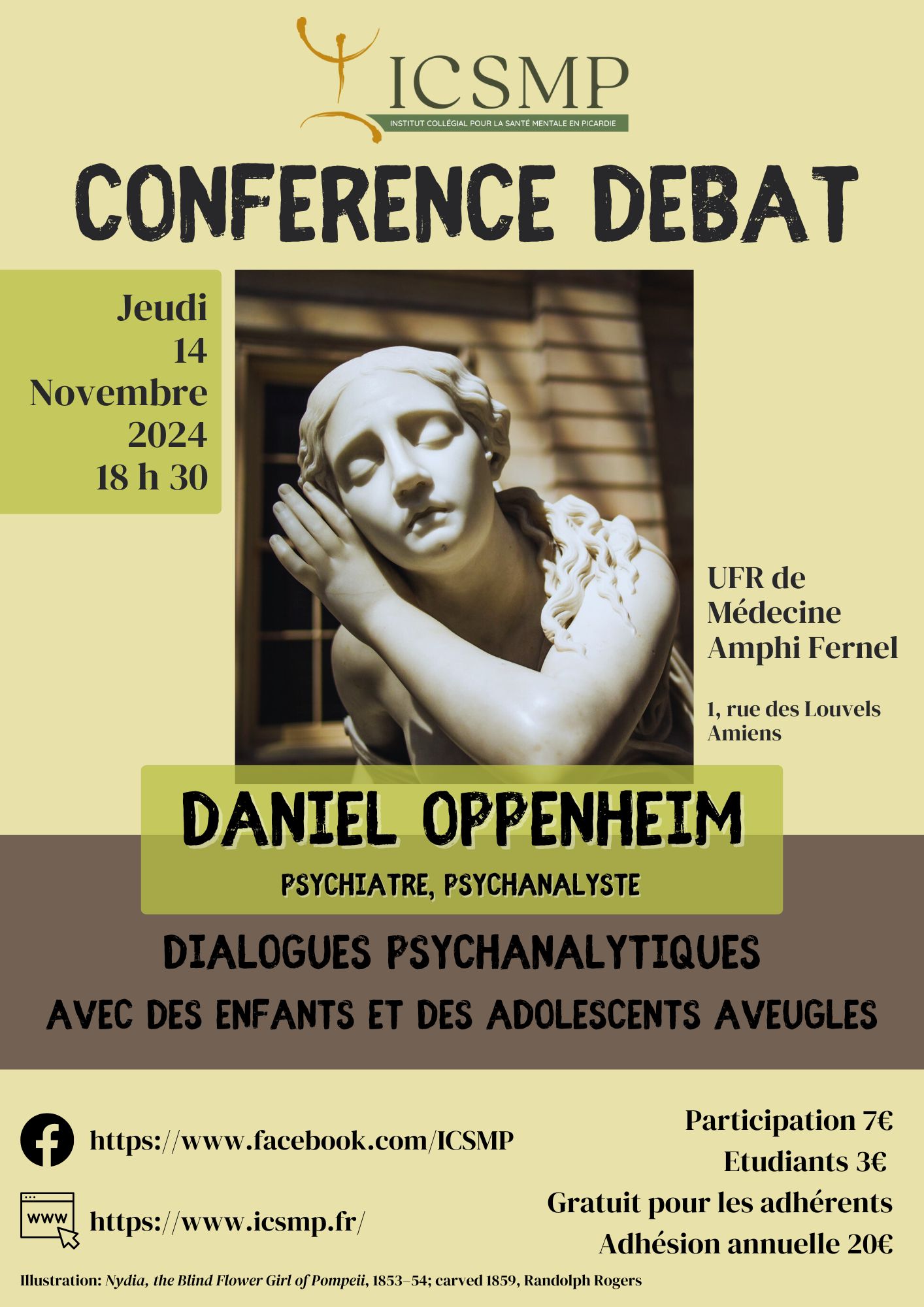
Après avoir travaillé 25 ans auprès d’enfants traités pour cancer, Daniel Oppenheim travaille depuis 13 ans auprès d’enfants et d’adolescents aveugles, congénitaux ou plus tardifs. Il témoigne de cette expérience dans son dernier livre, préfacé par Bernard Golse, « Dialogues psychanalytiques avec des enfants et des adolescents aveugles ». Il détaille cette clinique complexe du dialogue psychanalytique avec ces enfants dans de nombreux exemples et dans les réflexions théoriques qui en découlent.
Cette clinique confronte à de nombreuses questions qui intéressent tous les psychanalystes. Il s’agit d’abord de la place du regard dans la construction du psychique, et des conséquences de la cécité dans le rapport de l’enfant à son corps, aux autres, au temps et à l’espace, au monde. La cécité précoce a aussi des conséquences sur les façons de penser (en particulier le doute et la certitude excessifs), de parler, et sur l’extériorisation de la destructivité. Cette clinique tisse des liens avec celle de l’autisme. L’histoire familiale et le parcours de ces enfants souvent issus de pays traversés par des guerres, des dictatures et des génocides, exigent du psychanalyste de tenir compte dans ces dialogues certes de l’intrapsychique et de l’expérience subjective du handicap mais aussi de la confrontation de ces enfants et de leur famille à la violence du politique et du social. La soirée permettra d’aborder quelques-uns de ces thèmes.
A lire: une note de lecture du Pr Christian Mille sur l’ouvrage de Daniel Oppenheim, « Dialogues psychanalytiques avec des enfants et des adolescents aveugles »
Daniel Oppenheim. Psychiatre et psychanalyste, docteur en psychopathologie fondamentale. A toujours associé pratique privée et institutionnelle, principalement auprès des enfants et des adolescents : d’abord en centres communaux de pédopsychiatrie, puis pendant 25 ans en cancérologie pédiatrique, et depuis 13 ans auprès d’enfants aveugles et autistes. Il a cofondé et animé le comité SFCE-Psy au sein de la Société Française des Cancers de l’Enfant. Il a été membre pendant dix ans du comité Éthique et Cancer, présidé par Axel Kahn, Il a publié 16 livres et 450 articles dans des revues francophones et anglophones. Ses textes ont porté sur la violence biologique – celle du cancer et celle de la cécité – , sur la barbarie collective humaine et sur leurs effets sur leurs victimes, leurs proches et leurs descendants, ainsi que sur la destructivité des adolescents dans le contexte politique actuel.
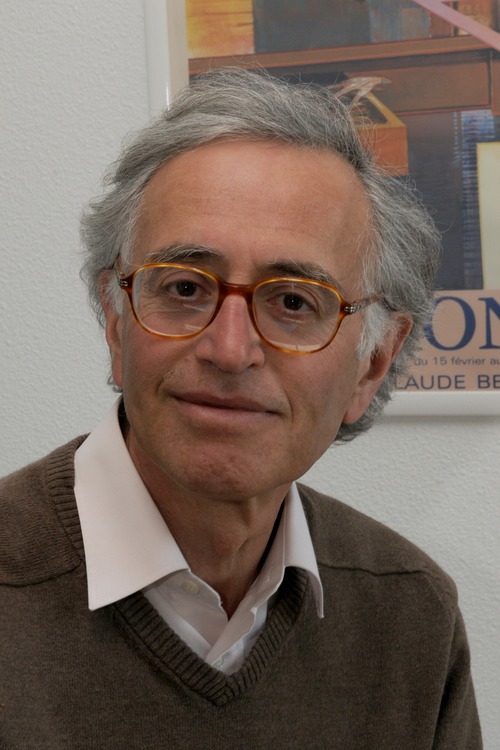

![[conférence-débat] Dialogues psychanalytiques avec des enfants et des adolescents aveugles](https://www.icsmp.fr/wp-content/uploads/2024/10/affiche-2-400x250.jpg)
![[Journée de travail] Autour de Régine Prat et de l’observation du nourrisson](https://www.icsmp.fr/wp-content/uploads/2023/10/regine-prat-400x250.jpg)